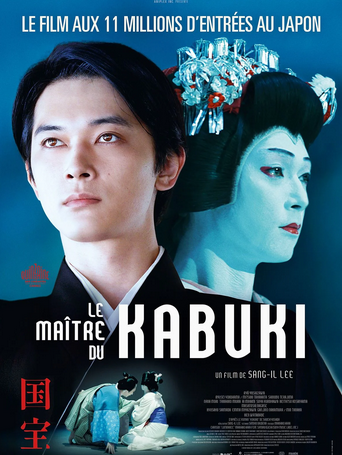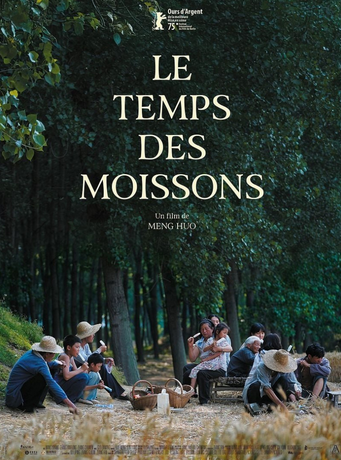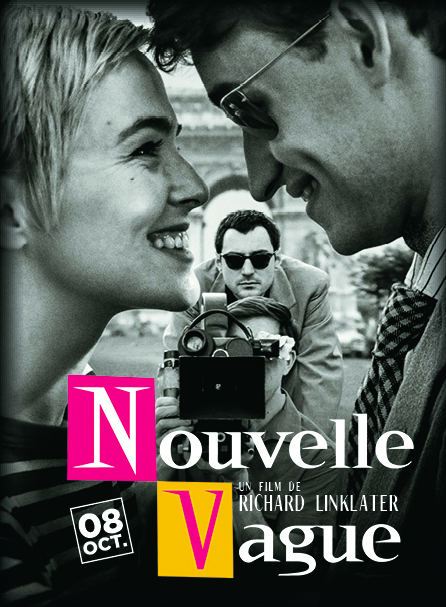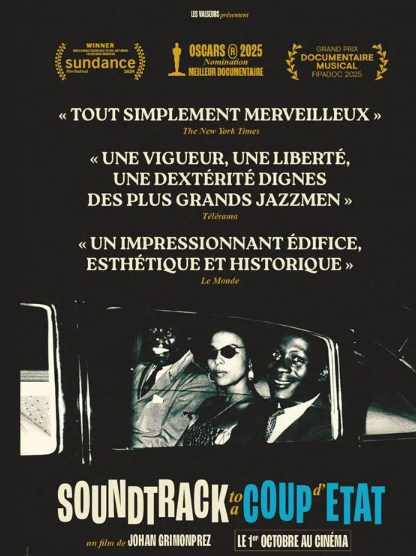Un peu plus d’une centaine de livres lus, moins d’une dizaine en VO, et un constat clair : ce n’est pas une bonne année pour la science-fiction dont les titres qui m’ont marqué doivent se compter sur les doigts d’une main. En conséquence c’est une sélection beaucoup plus éclectique. Je vous donne ça dans l’ordre alphabétique.
Les bons voisins, Nina Allan
J’avais lu ce livre en VO à sa sortie en 2021, mais l’écriture de Nina allan est tellement riche que je l’ai relu en VF cettte année. Ce n’est pas mon livre préféré de l’autrice (le créateur de poupées est pour moi son chef-d’œuvre) mais cette histoire mystérieuse de meurtre familial est malgré tout une grande réussite, et le livre mérite amplement le succès et les éloges qu’il reçoit depuis sa parution chez les excellentes éditions Tristram.
Aatea, Anouck Faure
Un monde aquatique, des îles vivantes, des pirates : on plonge vite dans ce roman d’aventures aux cotés d’Aatea et de son bateau, on se laisse emporter par les courant d’un bout à l’autre, on est émerveillé par ce nouveau monde. Ça ne m’étonnerait pas que ce beau roman obtienne le grand prix de l’imaginaire l’année prochaine.
Les terres indomptées, Lauren Groff
Lauren Groff nous livre ici, par le biais d’un retour à la nature, un sublime récit de libération d’une femme (je pique la conclusion de ma critique). Groff lutte à sa manière, par ses livres et par sa librairie située en Floride où elle vend les livres censurées dans les bibliothèques publiques de l’état, contre la chape réactionnaire qui s’étend sur les États-Unis. Lisez ses livres, ils sont formidables.
Soeurs, Daisy Johnson
Le fantastique sombre de ce roman a été adapté au cinéma sous le titre July & September. Deux soeurs, exilées dans un village de bord de mer suite à un événement dramatique. Aussi bien le film que le livre sont très forts, je vous laisse le choix du média.
Incandescentes, Hannah Kent
Au milieu du 19e siècle, des luthériens radicaux allemands émigrent vers l’Australie pour pouvoir pratiquer tranquillement leur religion. Un récit historique qui bascule d’un coup dans le fantastique, un récit familial dans un territoire en cours de colonisation.
Yellowface, R.F. Kuang
Changement radical de ton après l’excellente fantasy de Babel : Yellowface est un récit grinçant sur le milieu éditorial américain. On rit beaucoup dans cette farce mêlant appropriation culturelle et cynisme commercial.
Searoad, UK Le guin
Dernier inédit de l’autrice américaine, Searoad nous raconte, par le biais de douze nouvelles, la vie de femmes d’une petite ville de l’Oregon sur une période de 150 ans. Ai-je besoin de vous dire que c’est très bien ?
Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur, Harper Lee
Sud des États-Unis, années trente, un homme est accusé de viol sans preuve. Cet homme est noir, la femme est blanche, donc la justice va être expéditive. C’est raconté par une enfant dont le père, avocat, va s’occuper de la défense de l’accusé, même s’il sait que la cause est désespérée. Certainement le livre qui m’a le plus touché cette année, on ne peut qu’être au bord des larmes dans certains passages.
Tovaangar, Céline Minard
Un post-apo joyeux dans un Los Angeles redevenu un espace naturel et vivant. De l’émerveillement à chaque page.
Le Château d’Otrante, Howard Walpole
Petite plongée dans les œuvres fondatrices du roman gothique cet été : le Moine de Matthew Lewis, Les Mystères du château d’Udolphe d’Ann Radcliffe et le château d’Otrante. Des romans qui s’ils portent tous les marques du gothique sont totalement dissemblables par ailleurs.
Otrante, c’est un peu le gothique version Monty Python : de l’absurde, du comique de situation, des personnages haut en couleur, ce roman n’a pas pris une ride.
Du bout des doigts, Sarah Waters
En 1862, une jeune orpheline est recrutée par un escroc pour détourner la fortune d’une jeun héritière. Roman à suspense mêlant escroqueries, trahisons, érotisme et relation lesbienne, Du bout des doigts est le genre de livre qui vous happe et qu’on lit d’une traite ou presque (750 pages en poche quand même). Il a été brillamment adapté au cinéma par un réalisateur coréen qui l’a relocalisé, mais si je vous dis le titre cela risque de vous spoiler la lecture…
Vers ma fin, Sophie White
Un roman d’horreur psychologique avec des relations familiales étranges sur une petite île. Premier titre de la nouvelle collection d’horreur Styx, c’est une lecture âpre remplie de scènes marquantes.