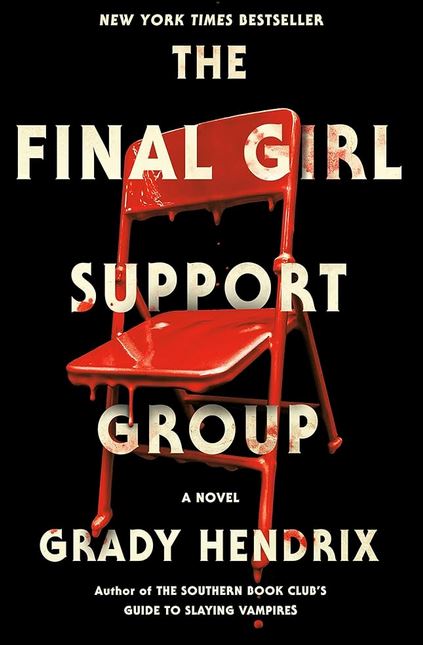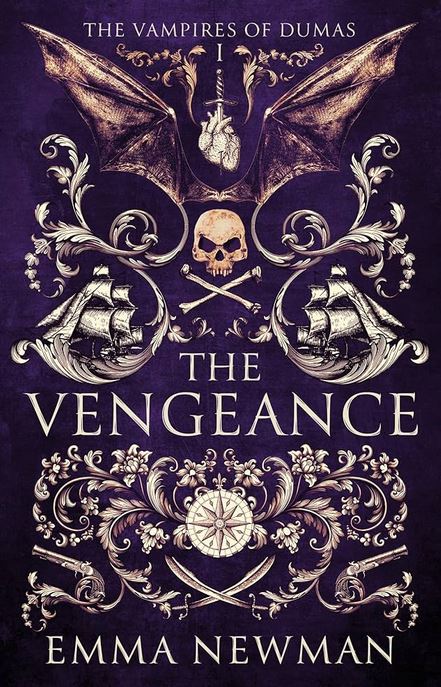
Morgane a grandi dans les caraïbes sur un bateau, fille de Anna-Marie, capitaine du vaisseau pirate The Vengeance. Mais lorsque celle-ci est mortellement blessée lors de l’abordage d’une goélette française, Anna-Marie apprend à Morgane qu’elle n’est pas sa fille mais sa nièce, et qu’elle l’a enlevée à sa vraie et cruelle mère, mariée au puissant conte d’Artois. Morgane décide alors de se rendre en France pour retrouver sa mère.
Emma Newman le dit dans la préface : elle a grandit avec Alexandre Dumas, aussi bien les livres que les diverses adaptations, et le Conte de Monte-Cristo a une place spéciale dans son cœur. The Vengeance est donc un hommage direct à ce livre et à son créateur. On y retrouve donc tout ce qui fait Dumas : des personnages haut en couleur, des aventures, des combats, de la fanfaronnade, avec ce qu’apporte en plus Newman : Morgane, ce personnage féminin aussi forte que décalée, qui suit parfois ses passions plutôt que la raison, qui découvre cette France rigoriste si loin de ses caraïbes, ainsi que quelques créatures fantastiques, dont les vampires annoncés sur la couverture.
The Vengeance est un roman léger, rapide, mouvementé et drôle. Une belle lecture de détente.
(lu en VO, pas de traduction annoncée)
(et on pardonnera quelques fautes de français dans les dialogues et quelques anachronismes)